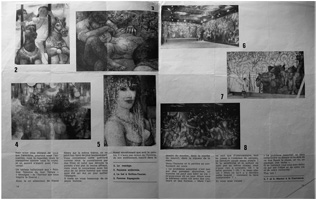WALDEMAR-GEORGE, Préface au catalogue de l'exposition dans la Galerie URBAN, 1960
|
Auteur de Trois heures au Musée du Prado, cet essai qui est le prototype, ou l’un des prototypes, d’une critique créatrice, Eugenio d’Ors ne nie pas l’existence de l’Ecole Espagnole, mais en conteste la spécificité et l’originalité. Theocopouli (Greco) allie au sentiment byzantin de la forme la ligne des Maniéristes, les grands rythmes des Baroques et la couleur faite de gemmes broyées de Jacopo Robusti. Velasquez procède à ses débuts du Caravage et du caravagisme. Avant d’imprimer à son art son caractère et cet accent uniques qui annoncent les audaces de la peinture moderne, Goya s’inspire de François Boucher et interprète librement Tiepolo. Mais Delacroix qui incarne le devenir de la peinture française et porte l’Impressionnisme sur les fonts baptismaux tend la main à Rubens et à Paul Véronèse. Monet rejoint William Turner. Crivelli et Shongauer sont frères. Les Ecoles nationales délimitées par des poteaux-frontières sont des leurres et de vaines constructions de l’esprit. |
Jean ROLLIN, L'Humanité, 31 janvier 1961
|
Le premier ouvrage consacré à Mentor vient de paraître. |
Jean GOLDMAN, Le Berry républicain, février 1961
|
Il et des peintres comme du vin. Un demi-siècle est là pour prouver que le climat parisien est plus particulièrement propice aux plantes étrangères qui ont été implantées sur les berges de la Sine. Parmi les cépages importés qui s’acclimatent exceptionnellement bien dans le creuset de l’Ecole de Paris, ceux d’Espagne sont parmi les premiers. Un livre consacré au peintre Mentor dont le texte est signé par Waldemard George*, est le dernier témoignage en date qui démontre avec clarté ce que l’Ecole de Paris doit au fils les plus doués que la péninsule ibérique déverse périodiquement sur notre capitale. *Arts et Editions du faubourg, Modernes de Charlie Chaplin |
Raymond COGNIAT, Le Figaro, 20 avril 1961
|
Waldemar George, dans une plaquette consacrée à Mentor, résume fort exactement ce peintre en ces mots : « Le monde de mentor s’impose à la fois par l’extrême rigueur de sa cadence, par ses formes projetées en gros plan et par son imagerie ». |
Jean ROLLIN, L'Humanité, 14 avril 1961
|
« C’est la vie prolongée ! » s’exclamait Théophile Gautier devant le tableau des Menines où Philippe IV et son épouse figurent par leurs portraits reflétés dans une glace. Le catalan Mentor a-t-il ravi à Vélasquez les secrets du fabuleux miroir ! Dans ses toiles récentes la vie se prolonge et l’image inventée par le peintre défie le modèle. |
Jean MARCENAC, Les Lettres Françaises, 22 avril 1961
|
Blasco Mentor est un de ces peintres, aujourd’hui si rares, qu’on n’a nul besoin de traiter en peintre. C’est d’homme à homme qu’il s’adresse à nous, dans le parfait langage d’une technique maîtresse de ses moyens, qui n’est jamais une fin en soi, et dont l’unique et inébranlable ambition est de dire. Aussi laisserai-je volontiers à tous ceux que séduit l’arc-en-ciel le plaisir de découvrir ses dons de coloriste, comme à ceux qui ont le goût, la joie d’exalter les vertus singulières de sa composition et son aisance archangélique dans le dessin. Je refuse, quant à moi, de m’étonner qu’un artiste connaisse son métier : il nous doit bien cela, à nous qui regardons, qui écoutons ou qui lisons. C’est pure politesse, et morale professionnelle que de chanter juste, de mettre l’orthographe ou d’articuler distinctement, même quand les bègues et les ignorants semblent faire la loi. |
Jean BARDIOT,Fiance, 20 avril 1961
|
Peu de peintres se sont consacrés, depuis Degas, au monotype qui nous a pourtant valu des chefs-d’œuvre. Mentor, peintre complet, s’est attaché à faire revivre ce genre oublié. Son exposition actuelle à la Galerie Urban est une splendide réussite. Le monotype, on le sait, exige de l’artiste la connaissance exacte d’une technique très particulière. C’est un autre jeu de l’amour et du hasard mais où il faut beaucoup d’amour. Ceux de Mentor sont pleins de mystérieuses beautés. Et ces « bonheurs » sont dus à la collaboration calculée de l’artiste et du hasard. Mais quand le peintre a, comme Mentor, le sens du monotype, la part du miracle, de l’inattendu, est moins grande. |
Jean-Paul CRESPELLE,France soir, 22 avril 1961
|
Depuis le début du siècle, c’est à Paris que se fait la peinture espagnole. A Picasso, Juan Gris, Manolo, Paco Durio, arrivés à Paris aux alentours de 1900, à Salvador Dali, Creixan, Pedro Florès, Dominguez, débarqués durant l’entre-deux guerres, une dernière fournée a succédé depuis la fin de la guerre civile. Fournée de qualité puisqu’on y compte Clavé, Pelayo, Grau-Sala. Le tout dernier venu, Blasco Mentor, arrivé en 1945, a commencé a se révéler il y a une dizaine d’année en exposant à la Galerie de l’Elysée. L’exposition que fait actuellement chez Urban ce Catalan – autre remarque : c’est la Catalogne qui a fourni le plus grand nombre d’artiste contemporain à l’Espagne – permet de mesurer l’évolution et la maturité de son talent. Très espagnol, Mentor s’était voué au départ à d sombres et tragiques scènes de tauromachie. Sous l’influence du climat français, il a éclairci sa palette, y a écrasé des teintes précieuses et fraîches, des roses fraise, des bleus turquoise, et s’est tourné vers de nouveaux sujets d’un expressionnisme moins âpre : le cirque d’abord – ce pont aux ânes des peintres depuis Degas – Les danseuses et les nus féminins. En abandonnant un peu de son âpreté, Mentor n’a rien perdu de son ardeur première. Par contre, il a gagné une plus grande puissance colorée, une plus vive sensibilité. |
Jean GOLDMAN,Le Berry républicain, 29 avril 1961
|
S’il est maintenant bien établi que les fils de la péninsule ibérique sont des plasticiens de qualité, et par tradition, Mentor ne fait que confirmer cette constatation. Son exposition à la Galerie Urban (18, rue du Faubourg-Saint-Honoré) le montre en progrès sensible, puisqu’il est un des rares peintres de sa génération à avoir acquis une palette rigoureusement personnelle et à se servir notamment de ses roses, ses bleus, ses rouges et ses ocres avec une science consommée. En l’occurrence, la trouvaille de Mentor c’est de mettre cette science au service de thèmes qui sont essentiellement espagnols en esprit, ce qui fait que le visiteur se trouve en présence d’une peinture tout à fait actuelle et même très « Ecole de Paris », me laissant filtrer un arrière-goût d’exotisme. |
Roland PIETRI,Le Berry républicain, 29 avril 1961
|
La dernière exposition de Mentor s’est ouverte le 14 avril. La signification de cette date a probablement échappé à la plupart des visiteurs qui se pressaient dans la galerie Urban le jour du vernissage. Cordial et fraternel comme il l’est par nature, enjoué comme il s’efforce de le paraître pour que personne ne sache son tourment, Mentor semblait tout à son succès. Sa pensée pourtant se reportait trente ans en arrière. Le 14 avril 1931, à Barcelone, presque enfant, il assistait dans l’enthousiasme à la naissance de la république espagnole. Il devait bientôt combattre pour la défendre puis connaître après la défaite, les camps et le sort de l’exilé. Certes, la terre de France lui fut hospitalière. Il n’y rencontra que sympathie, amitiés et y découvrit une conception de la vie, une vue du monde qui contribuèrent largement à la formation de l’homme qu’il est devenu. Mais les souvenirs d’enfance et de jeunesse, quels qu’ils soient, ne s’effacent jamais. |
Jean ROLLIN,L'Humanité, 13 octobre 1961
|
Quelle est la signification du mot « expressionnisme », qui désigne l’importante exposition d’œuvres de Nakache, Mentor, Foss et Letellier au musée Galliera ? Dans son récent ouvrage, La peinture expressionniste, Waldemar George rappelle qu’à un camarade lui signalant la longueur exagérée d’un bras de sa Médée, Delacroix rétorquait : « Je le sais, mais l’expression y est ». Ne s’agit-il pas là, suggère Waldemar George, d’une profession de foi expressionniste ? Et il ajoute : « Le mot d’ordre de l’Ecole pourrait être cet extrait de la lettre de Van Gogh dans laquelle le peintre de l’Arlésienne déclare : « Je désire exprimer par le rouge et le jaune les terribles passions humaines. »
Déformation volontaire de la réalité objective, exacerbation des couleurs et de leur rapport entre elles, caractérisent l’expressionnisme. On en trouve déjà maints exemples chez Bosch, Goya, Daumier. Parmi les modernes, Ensor, Permecke, Rouault, Picasso, Soutine et Gruber entre autres, doivent être considérés comme des porte-drapeaux de l’art expressionniste. |
Jean ROLLIN,L'Humanité, 31 décembre 1962
|
Mentor a intitulé Espagne 39 le tableau qu’il exposera pendant les mois de janvier, février et mars à l’occasion du 12e Salon des Peintres Témoins de leur Temps, au musée Galliera. Ce catalan exilé pouvait-il mieux répondre au thème proposé : « L’Evénement », que par un rappel des luttes et des souffrances de son peuple ? |
Arts, janvier 1963
|
"La guerre d’Espagne", de Blasco Mentor, d’une extraordinaire puissance tragique, est la plus saisissante sans doute des toiles inspirées par le thème de l’évènement. Bien différente de « Guernica », de Picasso, cette composition s’impose par son réalisme direct, presque insoutenable, mais ennobli par la pureté sculpturale, d’une étrange et poignante douceur, des beaux corps éternisés dans l’instant de la mort. |
R. W. DE CAZENAVELa côte des peintres, février 1964
|
Paris, ça chante dans toutes les têtes de tous les gars de vingt-cinq ans qui ont des choses à dire. |
Raymont COGNIATMedica n°41, septembre-octobre 1964
|
Dès le premier abord, l’art de Mentor ne semble se réclamer d’aucun précédent, n’appelle pas les références à des écoles et à des esthétiques de son temps ou du passé. Il se présente tout simplement comme une entité humaine sans se rattacher à quelque aîné ou à quelque contemporain. Ce n’est pas cependant un art orgueilleux, agressif, qui renie les autres expressions ; simplement il a son autonomie et il faut l’accepter ou le refuser tel qu’il est car il ne cherche pas à se justifier pas des raisonnements. En toute circonstance il reste plus près de la sensation que de la raison. Dans les commentaires qu’il a suscités on a pourtant cité le nom de Gromaire, parce que la plénitude de ses formes, et spécialement de ses nus, aboutit à des volumes nets, presque géométriques : mais il les a conçus en un temps où il ne connaissait pas encore l’œuvre de Gromaire. Lorsqu’il a vu celle-ci, lorsqu’on lui a signalé cette parenté, il en a été touché comme d’une révélation, comme la preuve que, lui aussi, était un peintre. En fait, la forme, chez Gromaire, est une stylisation volontaire, probablement issue du cubisme, mais avec quelque chose de sensiblement plus humain. Chez Mentor, ce n’est pas une conséquence de théories plastiques, mais un état de plénitude, d’épanouissement physique. Chez Gromaire le personnage est presque un symbole à force de rigueur, chez Mentor, au contraire, il est très individualisé. |
Jean ROLLIN, L'Humanité, 14 mars 1966
|
Le Grand Prix des Peintres Témoins de leur Temps a été décerné à Mentor, au cours d’une réception qui s’est déroulé vendredi soir, au Musée Galliera. De nombreux artistes, critiques d’art et personnalités parisiennes assistaient à cette manifestation. Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’occasion d la remise du prix (chevalet symbolique), Isis Kischka, secrétaire général des Peintres Témoins de leur Temps, indiqua que la récompense attribuée à Mentor était justifiée non seulement par le talent de cet artiste, mais par les qualités dont il a fait preuve depuis de nombreuses années en traitant de grands sujets. Ce sont précisément ces qualités qui ont motivé la décision de la municipalité de La Courneuve de confier à Mentor la décoration, à laquelle il travaille actuellement, de la Salle des Fêtes d’une nouvelle maison du peuple : 300 m2, sur le thème « La Conquête du bonheur ». |
Le Journal du canton d'Aubervilliers, 1er avril 1966
|
À la « Maison du Peuple » de La Courneuve : Mentor peint : « LA CONQUÊTE DU BONHEUR » |
L'Humanité, 20 février 1967
|
Le maire de la Courneuve, notre camarade Houdremont, a présenté samedi à un public d’artistes, d’écrivains et de critiques d’art, la monumentale fresque murale qui décore la salle des conférences et de spectacle de la nouvelle Maison du Peuple de la ville. Autour du maire et du peintre Blasco Mentor, créateur de cette magnifique « Conquête du Bonheur », on notait la présence de M. Jacquinot, secrétaire générale du syndicat de la presse artistique française, Jean Milhau, président de l’Union des Arts plastiques, Braun, éditeur, Maximilien Gauthier et Waldemar George, Roger Bordier, écrivains d’art, de Jean Marcenac, Francis Cohen, directeur de « La Nouvelle Critique », de Jacques Ralite, vice –président de la Fédération nationale des centres culturels communaux, Mme Banaigs, conservateur du Musée de Saint-Denis, des peintres Moretti, Taslitzky, Amblard, Clero, Milshtein, Beauregard, Pichette, Kischka, des critiques d’art Charmet, Adam, Daleveze, Dornand, Lannegrand d’Augimont, Tassart, Jean Rollin, des sculpteurs Salmon et Gibert, de M. Gaudibert, animateur du musée d’art moderne de la ville de Paris, etc. |
Maurice TASSART, Le Parisien libéré, 20 février 1967
|
L’inauguration de la « Maison du peuple » de la Courneuve, qui a eu lieu hier, aurait pu n’être qu’un événement local. Mais la façon dont a été conçue et réalisée sa décoration en fait l’équivalent de « Fée Electricité » de Dufy ou de la chapelle, peinte par Matisse des Dominicains de Vence. |
Maximilien GAUTHIER, Nouvelles littéraires, 23 février 1967
|
Une maison du peuple a été inaugurée dimanche dernier à La Courneuve. Œuvre déjà remarquable sous le rapport de l’architecture, elle comporte une salle de spectavcle dont la décoration murale, due à Blasco Mentor, peintre catalan de l’école de paris, est une admirable composition intitulée La Conquête du bonheur, mais qui pourrait aussi bien être l’Ascension de l’humanité. |
Journal du canton d'Aubervilliers, 24 février 1967
|
La Courneuve ne figure pas sur le parcours habituel des critiques d’art ; ce sont plutôt les musées et les galeries parisiennes qu’ils fréquentent. Un groupe d’entre eux, parmi les plus représentatifs, avait cependant répondu samedi 18 février à l’invitation de Jean Houdremont, de venir visiter la Maison du Peuple. Ils parcoururent le Foyer des Jeunes, les salles réservées aux réunions et aux jeux, les laboratoires photo, la bibliothèque. Mais bien entendu, c’est aux réalisations artistiques : le grand escalier hélicoïdal du hall dessiné par l’architecte communal René Py et pourvu d’une rampe élégante du maître-ferronnier Raymond Subes, l’héroïne Zoïa du sculpteur Salendre, et la décoration murale de 400 mètres carrés « La Conquête du bonheur » exécutée par Mentor dans la salle des spectacles qui devaient accorder le plus d’attention. |
Jean ROLLIN, L'Humanité, 3 mars 1967
|
Pour beaucoup de vieux parisiens, le nom de la Courneuve évoque encore le souvenir de l’explosion du dépôt de munitions qui ravagea cette bourgade de maraîchers il y a un demi-siècle. 44.000 personnes habitent maintenant La Courneuve, devenue cité industrielle. La municipalité communiste y multiplie les réalisations. Au nombre de celles-ci figure la Maison du peuple et de la Jeunesse Guy-Môquet, inaugurée le 19 février sous la présidence de Waldeck Rochet. Ce bâtiment, dessiné par l’architecte René Py, avait été présenté la veille aux critiques et écrivains d’art qui visitèrent le foyer, les laboratoires photo, la bibliothèque. Bien entendu, c’est aux travaux de décoration, exécutés par Subes et Mentor, qu’ils devaient se montrer le plus attentifs. Une récente exposition des œuvres du maître ferronnier Raymond Subes, à l’Ecole Polytechnique, a mis en lumière la qualité de son invention et l’étendue de son savoir. La pierre, le béton, la verdure des jardins servent de support ou de cadre à sa création. |
Jean JACQUINOT, Journal de l’Amateur d’art, 25 mars 1967
|
Nous ne saurions trop applaudir aux efforts poursuivis par les municipalités de grande banlieue parisienne. Après Saint-Ouen, La Courneuve na mérite que des éloges. Son maire n’a-t-il pas confié au peintre espagnol Mentor (que nous admirons plus que Picasso, n’en déplaise à l’illustrissime maître récemment adulé), la décoration de la salle des fêtes de sa « Maison du Peuple » ; vaste surface qui a permis à l’artiste de donner libre cours autant à sa fougue qu’à sa sensibilité. |
J.-M LANNEGRAND D'AUGIMONT, Regain, mars 1967
|
Pourtant ce n’est pas à Paris, mais à La Courneuve, que nous avons connu la joie artistique la plus complète de février finissant. À La Courneuve, oui. En visitant dans cette cité ouvrière en pleine expansion, la nouvelle Maison du Peuple, plus spécialement destinée aux Syndicats et à la Jeunesse. D’une architecture sobre, le bâtiment s’est surtout imposé à nous par l’exceptionnelle beauté de sa décoration intérieure. Dès l’entrée, dans le grand hall lumineux, non loin d’un buste superbe de Salendre, on peut admirer, en effet, une rampe d’escalier d’un dessin et d’une technique remarquables, chef-d’œuvre du maître ferronnier Raymond Subes. Mais là n’est pas la merveille. C’est en entrant dans la salle des conférences et de spectacle qu’à notre suite vous la découvrirez. Sur la totalité des murs, sur le rideau des scène, sur le plafond, soit sur quelques 400 m2, celle-ci est peinte ; Une immense fresque qui tournoie, vous enveloppe, vous étreint : la Conquête du Bonheur. Depuis les études préparatoires, les projets, les maquettes, jusqu’à son achèvement, elle a demandé près de deux années de travail à Blasco Mentor, son créateur inspiré. Le thème s’ordonne avec noblesse tout au long de la gigantesque composition. Le dessin est de haute qualité, les groupements heureux, les couleurs d’une rare somptuosité. Cette quête du bonheur terrestre est un hymne à la vie, un chant exaltant et grave, une incantation puissante, issue du fond des âges, d’une étrange résonance. C’est beau comme une chapelle romane, pourrait-on dire. Car cet ensemble monumental, unique dans la région parisienne, atteint à une singulière harmonie. Aussi, tous ceux qui ont contribué à sa réalisation peuvent-ils être fiers de cette extraordinaire réussite. Si vous passez un de ces jours prochains sur la vieille route de Flandre, arrêtez-vous à La Courneuve et visitez la merveille signée par Mentor. Vous ne le regretterez pas ! |
Raymond CHARMET, Medica, avril 1967
|
Mentor, ce beau nom retentissant est celui qu’Homère donnait à la Déesse de la sagesse, Pallas Athénée, incarnée dans un vieux héros raisonneur, resté proverbial. Aujourd’hui, c’est celui d’un peintre espagnol de Paris, un passionné réfléchi, l’un des artistes les plus étonnants que l’on puisse rencontrer, le seul créateur actuel d’une décoration murale somptueuse comme celle de la Renaissance, la Conquête du bonheur, à la Maison de la Culture de La Courneuve. Il faut la saluer comme une grande œuvre primitive, l’aurore de cette révolution que l’on attend depuis longtemps dans l’art moderne, l’exaltation de la force fantastique de l’humain et de l’amour, hantise profonde de notre monde compliqué, avide d’unité. Quelques critiques dont George Besson qui fut le premier à s’enthousiasmer pour lui. Waldemar George et le jeune Jean Rollin, ont reconnu l’importance de ce peintre indépendant, en vérité bien singulier. Les contrastes paradoxaux de sa race sont poussés en lui à l’extrême – tempérament d’une vigueur irrésistible, doué d’une puissance de travail formidable, Mentor est en même temps un délicat, un raffiné épris de grâce et de noblesse. Révolutionnaire farouche, qui a quitté l’Espagne après la guerre civile, athée convaincu, il déclare que le plus grand poète est saint Jean de la Croix. De plus, à l’absolu de l’âme espagnole, il a uni la culture française, dont il vénère la clarté et le rationalisme.
Son art est tout aussi complexe, car rien de grand ne naît de l’élémentaire. « Je suis un peu primitif », dit-il, mais il invoque l’Egypte, la Grèce, admire éperdument Vélasquez et Goya. Il fut un enfant prodige, obtint le premier prix de dessin à l’Ecole des Beaux-arts de Barcelone en 1945, eut un tableau acheté par le musée de cette ville en 1935, à l’âge de quinze ans. Peintre de sujets populaires, voire prolétariens, il aime Raoul Dufy. |
L'Humanité, 1erfévrier 1968
|
Le peintre Mentor vient de faire don au Comité national pour le soutien et la victoire du peuple vietnamien, de son tableau actuellement exposé au 19e Salon des Peintres Témoins de leur Temps. Intitulé Bombardement au Vietnam, cette vaste toile (3 X 3 m) aux harmonies de deuil et d’incendie, occupe tout un panneau au musée Galliera. Elle transpose sur le mode épique une vision de l’enfer déchaîné à leur passage par les avions yankees : une nuée de robots monstrueux, dont les mufles sont des canons et des mitrailleuses, a envahi l’espace et fonce vers la Terre. Dans sa monumentale décoration exécutée à la Maison de la Jeunesse de La Courneuve, Mentor célébrait La Conquête du Bonheur. C’est ici le génocide qu’il dénonce. Bombardement au Vietnam, qui témoigne avec maîtrise des crimes perpétrés, par Johnson, sera vendu au profit du peuple héroïque pour l’aider à vaincre. |
L'Humanité, 4 mars 1968
|
Événement, samedi à Saint-Denis où la municipalité présentait le grand tableau de Mentor « Bombardement au Vietnam », acheté par la ville pour son musé. |
Micheline SANDREL, Lettres et Médecins, avril 1968
|
Vous faites de beaux portraits, Mentor, un seul trait léger et les yeux de votre femme, sa bouche, sa façon de tenir la tête s’inscrivent en quelques secondes sur le papier comme ils sont inscrits dans votre tête. |
André PARINAUD, Medica n°81, novembre 1969
|
Chaque siècle a son Rubens et les hommes d’un temps, en admirant son œuvre, communient déjà avec le futur, qui verra dans cet art, l’imaginaire, la sensibilité, l’écriture d’une époque. La nôtre se nomme sans doute Picasso et sa puissance jette une telle ombre que bien des maîtres, qui l’ont quelquefois égalé, ou précédé dans certaines de ses périodes, se trouvent éclipsés ; au point que, si l’on devait nommer les quatre ou cinq noms, capables de la grande postérité, il ne faudrait sans doute pas les chercher dans le peloton de tête de l’actualité. Le chêne règne sur la forêt. |